Thèse de chimie organique présentée à Faculté des
Sciences de l'Université de Paris
pour obtenir le grade de Docteur d'Université
par ¶
Jean-Pierre Lechartier
Contribution à l'étude des
dérivés du benzo (b) thiophène Bz-hydroxylés et des thiénobenzofurannes
soutenue devant la commission d'examen :
Normant, H., président
Rumpf, P., Mentzer, C., examinateurs
INTRODUCTION
Les très nombreux
travaux suscités par le benzo (b) thiophène - ou "thianaphtène" -
ont plus particulièrement porté sur les diverses méthodes d’édification de
cette molécule et de ses homologues alcoylés, sur la réactivité chimique des
deux sommets de son hétérocycle, sur l'hydrogénolyse - sous l'action du
nickel de Raney - de certains de ses dérivés fonctionnels et sur son
utilisation pour la préparation d'isologues soufrés des composés bicycliques
doués d'activité pharmacologique. Des recherches approfondies ont été
consacrées à ses deux dérivés mono hydroxylés sur l'hétéro-cycle - le
thioindoxyle ou hydroxy-3 thianaphtène et le thiooxindole ou hydroxy-2
thianaphtène - par suite de l'intérêt qu'ils présentent pour la synthèse des
matières colorantes thioindigoïdes.
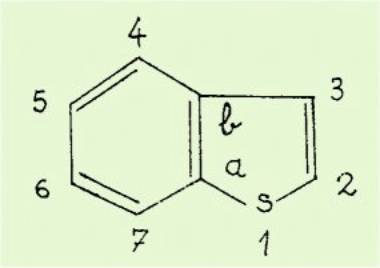
Par
contre, on connaît peu de choses concernant les dérivés hydroxylés sur
l'hémicycle du benzo (b) thiophène. Un dépouillement exhaustif de la
littérature nous a révélé qu'il n'existait pas plus de 125 composés mono
hydroxylés de ce type et une cinquantaine d'autres qui sont polyhydroxylés,
parmi lesquels près de trente dérivent du thioindoxyle. Si les quatre
représentants fondamentaux de cette série - à savoir les quatre bz-mono
hydroxy benzo (b) thiophènes - ont été décrits, il reste très difficile de
les préparer en quantités appréciables par des méthodes simples et
reproductibles. C'est ainsi que le plus étudié parmi eux, l'hydroxy-4
thianaphtène, est formé à partir du thiophène avec un rendement qui ne
dépasse pas 15% selon une technique décrite dès 1955 par Fieser et Kennely et
maintes fois reproduite depuis, sans qu'aucun auteur n'ait jamais pu
l'améliorer de façon notable ! Quant aux trois autres isomères, on peut
prétendre sans exagération qu'ils restent des curiosités de laboratoire. On
les obtient incidemment à partir de dérivés thianaphtèniques dont les
synthèses sont elles-mêmes fort laborieuses, ou bien par des procédés en
principe univoques mais qui n'ont jamais été mis au point et dont
l'application est aussi capricieuse qu'incertaine. Cela explique sans doute
pourquoi si peu dou-leurs ont essayé d'approfondir l'étude de substances
aussi peu accessibles. L'essentiel de ce qui est connu en matière de
bz-hydroxy thianaphtènes est dû à Martin-Smith et à ses collaborateurs et à
Tilak et à ses collaborateurs qui travaillent, respectivement, en Angleterre
et aux Indes.
Le
premier but que nous avons poursuivi en réalisant le présent travail était de
contribuer, dans une certaine mesure, à combler cette lacune.
Nonobstant
cette préoccupation générale, l'étude des bz-hydroxy thianaphtènes nous
intéressait de plusieurs autres points de vue.
- Depuis 1960, la chimie du benzo (b) thiophène constitue l'un des principaux
thèmes de recherche de notre laboratoire. Plusieurs travaux y ont été
consacrés à la formation et à la détermination des structures des dérivés
acylés de cette molécule. Il y a été démontré que le sommet 6 - en méta de
l'hétéroatome - est le plus réactif sur l'homcycle du thianaphtène vis-à-vis
des agents d'acylation. Il nous a semblé utile de préciser l'influence que
pourrait exercer un groupement hydroxylé sur l'orientation d'une telle
acylation.
- En dehors de cette thèse, nous avions commencé nos propres recherches de
chimie organique en participant à plusieurs travaux sur l'hydrogénation
désulfurante de divers types de composés thianaphtèniques. Nous avions ainsi
pu mettre au point de nouveaux modes de synthèse de composés plus ou moins
difficiles à former selon d'autres voies, tels que certains diphényl alcanes
hydroxylés, des benzofurannes 7-substitués et des benzosubérannes et
benzosubéronnes. L'adjonction de substituants hydroxyl sur les matières
premières thianaphtèniques devait élargir le champ d'application de ces
synthèses. Nous envisagions en particulier d'utiliser l'hydrogénolyse
d'hydroxythianaphtènes pour élaborer des phénols benzéniques alcoylés qui
nous étaient nécessaires pour l'étude que nous développions par ailleurs des
corrélations entre la structure moléculaire et l'acidité de ces composés.
- Grâce au groupement hydroxyl fixé sur l'homcycle, nous pouvions édifier un
cycle furannique sur le squelette thianaphtènique. Par ce moyen, nous devions
élaborer un type pratiquement inconnu de structure à deux hétéroatomes dont
l'étude nous serait ainsi ouverte. En particulier, une telle structure devait
nous permettre de revenir, par désulfuration, à la série du benzofuranne et
de construire des ana-logues polyhétéroatomiques des hydrocarbures
polycycliques qui pourraient éventuellement se révéler être des agents
cancérogènes ou compétiteurs de la chimiocancérogènèse.
- La Chimie du benzofuranne est la spécialité principale de notre laboratoire
en matière de chimie organique proprement dite. En ce domaine, plusieurs
recherches de nos collègues portent depuis longtemps sur les dérivés
bz-hydroxylés du benzofuranne qui ouvrent la voie à des molécules naturelles
ou d'intérêt biologique comme les furocoumarines et les furochromones. Il
était intéressant de développer une étude parallèle des isologues soufrés de tels
dérivés hydroxyl et d'approfondir ainsi la comparaison déjà entreprise par
plusieurs d'entre nous entre le benzofuranne et le benzo (b) thiophène.
Nous
avons regroupé les tentatives que nous avons effectuées, les résultats que
nous avons enregistrés et les conclusions auxquelles nous avons abouti en ces
divers domaines, pour les présenter dans l'ordre logique qui fera le plan de
notre exposé :
- Chapitre II : Préparation dès-matières premières.
- Chapitre III : Contribution à l'étude de la réactivité des bz-hvdroxy benzo
(b) thiophènes.
- Chapitre IV : Préparation de phénols substitués par hydrogénation désulfurante de
bz-hydroxy benzo (b) thiophènes alcoylés
- Chapitre V : Synthèse et propriétés de thiénobenzofurannes édifiés sur les
bz-hydroxy benzo (b) thiophènes.
Du
point de vue de la systématique, ces recherches nous permettent de décrire 11
composés nouveaux. Parmi ceux-ci, il se trouve 55 dérivés bz-hydroxylés du
benzothiophène ce qui représente une contribution originale correspondant, du
point de vue formel, au tiers environ de ce qui était connu en ce domaine
avant le présent travail. Nous donnerons la liste de ces composés en annexe
après la description expérimentale de nos résultats.