Thèse de
science naturelle présentée à Faculté des sciences
de
l'Université de Lyon
pour obtenir
le grade de Docteur es Sciences naturelles
par
Darius Molho
Préparations
synthétiques et mode d'action de quelques hypoprothrombinemiants. Relations entre
la structure chimique et l'activité pharmacologique
soutenue le
28 novembre 1953
devant la
commission d'examen :
Cordier, D.,
président
Mentzer, C.,
Colonge, J., examinateurs
INTRODUCTION
A -
Position du problème
Le domaine thérapeutique s'est enrichi, ces dernières
années de l'apport indépendant de 2 séries de substances naturelles ayant
permis, jusqu'à un certain degré le contrôle des syndromes hémorragiques et
thrombosiques : ce sont les vitamines K et le dicoumarol.
Dam observa en 1929, qu'un régime renfermant toutes les
vitamines connues jusqu'alors, ne permettait pas la survie de jeunes
poussins. Les signes hémorragiques qui apparaissaient étaient évitables par
l'ingestion de luzerne, et on put montrer, que le principe actif, la vitamine
Kl, élaborée ultérieurement par synthèse, était seule responsable de cette
guérison.
De leur côté, Schofield, puis Roderick, observaient que la
présence de mélilot gâté dans l'alimentation du bétail amenait des troubles
hémorragiques.
La détermination du principe
actif du fourrage avarié : le dicoumarol, et l'étude de son action sur la
prothrombine plasmatique conduisirent Quick, Link et son école, puis Meunier
et Mentzer et Woolley à rechercher l'antagonisme entre dicoumarol et vitamine
E.
Mentzer et Meunier, en
présence de la similitude des formules développées du dicoumarol et de la
plus simple des vitamines K ; le phtiocol dégagèrent la notion d'antivitamine
K. Il est bon d'insister ici sur le fait que dans cet exemple de couple
vitamine - antivitamine, c'est la découverte fortuite de ces substances
naturelles puis des travaux indépendants sur chacune d'elles qui ont conduit
à penser à une interférence mutuelle.
Cette notion d'antivitamine,
ou d'antimétabolite en fonction de l'analogie structurale, dont la voie avait
été tracée par Woods et Fildes lors de la découverte de l'antagonisme entre
l'acide p-aminobenzoïque (corps naturel) et les sulfamides (corps
synthétiques artificiels) a été beaucoup généralisée par la suite et a permis
de nombreux travaux.
Ainsi, à l'heure actuelle, aussitôt après la découverte
d'un métabolite essentiel, la tendance normale est de chercher dans un but
pharmacologique, 1'antimétabolite correspondant et cela, par l'adjonction de
modifications structurales conduisant à des produits synthétiques non
naturels. Nous citerons comme exemples ; la vitamine B1 et la pyrithiamine.
la vitamine B2 et la dichloroflavine, la phénylalamine et la thiénylalanine,
etc.
Réciproquement, la découverte des antibiotiques naturels
tels que pénicilline, streptomycine, chloromycétine etc... et l'étude de leur
mode d'action a conduit les chercheurs à déterminer quel était le métabolite
essentiel dont l'utilisation est bloquée par 1'antibiotique en question.
Ainsi, Simmonds a montré un antagonisme entre la pénicilline (considérée
comme un dipeptide) et des dipeptides naturels contenant la glycine. Nous
mêmes avons trouvé un léger antagonisme entre la chloromycétine et son
analogue structural, la glycylphénylalanine.
Ces couples nous prouvent combien est féconde- cette voie
de recherches qui a été pour la première fois appliquée aux animaux
supérieurs, grâce à l'étude de l'antagonisme vitamines K - dicoumarol
(substances naturelles).
L'intérêt thérapeutique du
dicoumarol conduisit les chercheurs à synthétiser au laboratoire des
substances ayant des rapports structuraux avec celui-ci, capables
éventuellement, de le remplacer et d'en éliminer les incidences dangereuses,
à savoir 1'apparition d'un syndrome hémorragique grave au lieu d'un effet
antithrombosique fugace.
B - Plan du travail
Dans le présent travail, nous signalerons dans une première
partie les principales substances synthétiques élaborées déjà dans ce
domaine, puis, notre propre contribution à ces recherches, à savoir :
synthèse de corps nouveaux et recherche de l'entité structurale responsable
de l'activité hypoprothrombinémiante de diverses séries chimiques.
Dans une deuxième partie, nous examinerons une activité
secondaire que nous avons rencontrée pour plusieurs de nos agents prothrombopéniques
: leur faible activité oestrogène. Un essai de dissociation de ces doux
sortes d'activité sera également rapportée.
Dans une troisième partie,
biologique, nous étudierons :
1°) Le mode d’action d'un des
dérivés hypoprothrombinémiants particulièrement actifs que nous avons
signalés, la phényl-indanedione et son intervention éventuelle sur les
principaux facteurs de la coagulation.
2°) L’activité comparative de
quelques aryl-indanediones comme facteurs hémorragiques chez le rat.
3°) l'activité anticoagulante éventuelle, de tous ces
dérives, étudiée in vitro
a - action sur les divers
facteurs de la coagulation
b - action
anticoagulante comparative
Enfin, dans, une quatrième
partie, chimique, nous décrirons les méthodes ayant permis la synthèse des
différa tes substances mentionnées dans ce travail.
C - Définition des données
biologiques
Coagulation sanguine et
hypoprothrombinémie
L'hypoprothrombinémie est la traduction d'un trouble de la
coagulation sanguine par déficience en prothrombine. Si on. admet dans ses
grandes lignes la théorie de Morawitz,.la coagulation sanguine de nature
diastasique fait appel à au moins 4 éléments: le fibrinogène (globuline du
plasma), la prothrombine (globuline renfermant un
galacto-acétyl-glucosamino-mannose), la thromboplastine (euglobuline
lipoïdique) et le calcium.
Le fibrinogène, d'origine hépatique, se trouve normalement
dans le sang à la concentration de 2,5 g à 4 g par litre. Pratiquement, le
ternes de coagulation est indépendant du taux de fibrinogène, et les
afibrinémies, relativement rares, ne commencent à être dangereuses qu'au
dessous de 0,5 g de fibrinogène par litre.
La thromboplastine, d'origine tissulaire ou plasmatique,
est absente à l'état libre dans le sang circulant ce qui explique la fluidité
permanente de ce dernier. Les déficiences dans la formation de
thromboplastine plasmatique au cours d'un. traumatisme sont à l'origine de
l'hémophilie.
Mais c'est à la prothrombine qu'est dévolu le rôle
essentiel de l'hémostase. En présence de calcium et de certains activateurs,
dont la thromboplastine, elle est convertie en thrombine et c'est cette
dernière qui transforme le fibrinogène soluble en fibrine insoluble sous
forme-de caillot. La prothrombine qui se trouve normalement on quantité très
faible dans le plasma sanguin (200 mg par litre selon Seegers) gouverne la
coagulation sanguine.
En effet, les hypoprothrombinémies, à la suite d'atteintes
hépatiques (cirrhoses, ictères), d'avitaminose K ou d'intoxication par le
mélilot gâté, entraînent un syndrome hémorragique. Mais l'apparition
intraoculaire de caillots, avec. risque d'embolie, à la suite de stases
sanguines, n'est pas moins grave. Elle est à l'origine des phlébites
obstétricales ou post-opératoires et, d'une façon générale, est le lot de
certains malades prédisposés aux thromboses (thromboses des coronaires,
infarctus du myocarde etc....). On conçoit dès lors que chez de tels sujets
la "fluidification" du sang soit souhaitable et que la
thérapeutique ait été amenée à faire appel aux anticoagulants.
Le premier en date,
l'héparine, qui est un anticoagulant physiologique, est obtenu de nos jours
industriellement par extraction à partir du poumon de bœuf. Il rend le sang
incoagulable en se complexant avec les éléments circulants nécessaires à la
coagulation. Son action est de courte durée. C'est pourquoi, chez les malades
prédisposés aux thromboses, on a cherché à réduire les risques de coagulation
intra-veineuse, non pas en rendant le sang incoagulable in situ mais
on diminuant la synthèse hépatique d'un des facteurs primordiaux de la
coagulation ; la prothrombine.
Les premières recherches ont
eu pour tendance de domestiquer dans ce sens le principe actif hémorragipare
de la maladie du mélilot gâté et nous verrons que c'est grâce à des études
basées sur des analogies structurales que la pharmacopée a pu enrichir son
arsenal en drogues, capables d'abaisser le taux de prothrombine sans
cependant risquer l'hémorragie.
CONCLUSIONS GENERALES
L'étude des relations entre
la structure chimique et l'activité pharmacologique a été effectuée dans le
domaine des hypoprothrombinémiants. Nous ne reparlerons pas ici de toutes les
structures tant hétérocycliques que naphtaléniques qui se sont avérées
dépourvues d'activité; mais nous retiendrons que partant de la structure du
dicoumarol :
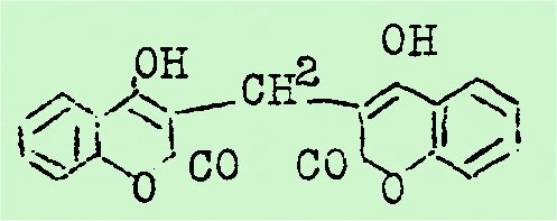
par simplifications successives, en passant par des corps à cycle potentiel très actifs :
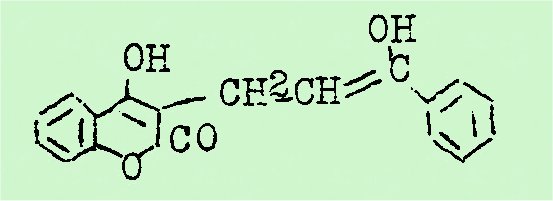
puis simplement asymétriques, te1s que la phényl-3 hydroxy-4 coumarine, moyennement active :
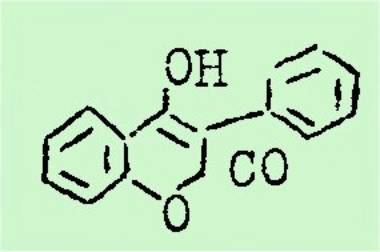
nous avons abouti à la phényl-indanedione :

qui, chez l'homme, est aussi active que le dicoumarol. Ce produit dérive de la phényl-3 hydroxy-4 coumarine par suppression du groupement (-0) dans la structure lactonique.
Les modifications
structurales effectuées sur le PID ont permis de préciser que l'activité
hypoprothrombinémiante était liée essentiellement à la faculté d'énolisation
du groupement dicétonique.
Le P.I.D., considéré comme
tête de série, a rendu possible la synthèse de nombreuses autres
aryl-indanediones nouvelles et toutes aussi actives; la plus active,
comparativement chez le rat, s’étant révélée être celle dont l'encombrement
spatial se rapprochait le plus du dicoumarol, à savoir l’a-naphtyl-indanedione :

Nous avons parallèlement
effectué une étude entre la structure chimique et l'activité pharmacologique,
relativement à la faible action oestrogène que nous avons décelée chez
plusieurs agents prothrombopéniques précédemment étudiés. Il nous a été
ensuite possible de dissocier les deux activités hypoprothrombinémiante et
oestrogène et nous avons ainsi obtenu des dérivés uniquement hémorragiques,
uniquement oestrogènes
Ce travail structural, tondant à différencier les
groupements chimiques indispensables à l'activité de même que l'encombrement
spatial nécessaire, une fois achevé, encore fallait-il déterminer si, parmi
toutes les structures étudiées à l'image du dicoumarol, une des plus simples,
celle du P.I.D. possédait également le-même mécanisme d'action sur la
coagulation ou bien si ces analogies structurales étaient seulement des vues
de l'esprit ?
C'est pourquoi, nous avons étudié chacun des facteurs
intervenant dans la coagulation et 1'influence du P.I.D. sur chacun d'eux. En
fonction de cette étude biologique, nous pouvons dire que le P.I.D. agit
comme le dicoumarol; il abaissé in vivo sensiblement la prothrombine
d'également le facteur VII; il ne diminue que faiblement, et seulement à
fortes doses, le facteur V; il réduit la concentration en facteur sérique
Spca, comme dans le cas du dicoumarol, et enfin, il diminue l'antithrombine
plasmatique. Dans un tout récent travail, Seegers vient de constater, et ceci
confirma nos résultats, que le dicoumarol s'attaquait à une nouvelle antithrombine
plasmatique progressive.
Nous avons aussi étudié
1'influence du P.I.D. sur les facteurs de la coagulation in vitro pour
essayer de déterminer si son mode d'action n'était pas également comparable à
celui de l'héparine.
L'étude effectuée sur la
conservation des plasmas en présence de P.I.D. a montré que si ce dérivé
n'avait pas d'action anticoagulante immédiate ni d'action antithrombine, il
était cependant capable d'accélérer la déperdition des facultés de
coagulation des plasmas par destruction du facteur labile et aussi
d'accélérer la destruction de-la thrombine. Ces pertes de facteurs in vitro
en présence de P.I.D. relèvent très probablement d'un phénomène oxydatif
puisque l'acide ascorbique les prévient; une étude comparative effectuée avec
la plupart des dérivés synthétisés par nous-mêmes a montré que les substances
les plus actives in vivo étaient celles qui influençaient au maximum la
conservation d'un plasma.
L'étude in vitro
entreprise avec le P.I.D. a incidemment permis de mettre en relief
l'apparition d'une antithrombine immédiate nouvelle, au cours de la
conservation dos plasmas à 57°, antithrombine différente des antithrombines
progressives normales et de l'antithrombine immédiate qu'est l'héparine. Le
P.I.D., in vitro, semble freiner l'apparition de cette nouvelle
antithrombine.
En fonction de toutes ces
données, le P.I.D. qui présente avec le dicoumarol une relation structurale
dans la seule existence d'un groupement énolisable commun a cependant le même
mécanisme d'action que le dicoumarol non seulement vis-à-vis de la
prothrombine, mais encore vis-à-vis des autres facteurs de la coagulation. De
plus, il présente un antagonisme comme le dicoumarol, avec la-vitamine K.
Il a des propriétés
oestrogènes analogues et il agit sur les capillaires de façon comparable. Ces
deux dérivés, à première vue. dissemblables, ont donc un mode d'action
identique.
Au point de vue synthétique,
de nombreuses substances appartenant à des classes chimiques variées ont dû
être réalisées et nous avons fait appel à un arsenal de méthodes chimiques
variées et partant, disparates.
Cependant, ayant eu
l'occasion, pendant ce travail, de réaliser, en collaboration avec C. Mentzer
et P. Vercier, une nouvelle méthode de synthèse de chromones, il nous a paru
bon d'envisager une interprétation relative à la synthèse des hétérocycles en
général, interprétation qui tendrait a concevoir que, dans les nombreuses
méthodes chimiques mises en oeuvre, se rencontre une grande unité,.
Enfin, nous décrivons une
nouvelle méthode d'obtention des hydroxy-naphtoquinones et nous signalons une
nouvelle méthode d'oxydation quantitative des aldéhydes aromatiques en acides
correspondants, méthode également capable d'opérer la dégradation des
aryl-indanodiones en acides phtaliques et acides aryloïques correspondants.
Nous espérons que ce travail,
forcément incomplet parce que trop vaste, puisqu'il nous a obligés à
approfondir des domaines très variés, aura au moins 1'avantage de mettre en
lumière le fait que, des notions d'analogie structurales, purement
spéculatives, peuvent cependant aboutir à la synthèse d'agents
pharmacologiques précieux en thérapeutique.