Thèse présentée à
l'Université Pierre et Marie Curie, Paris VI
pour obtenir le grade de
Docteur es Sciences physiques
par
Bernard
Bodo
L’acide
bourgéanique : nouveau métabolite des lichens
Structure,
synthèse et biosynthèse
soutenue le 18 juin 1975
INTRODUCTION
Depuis longtemps les «substances des lichens» ont attiré
l'attention des chimistes et, dès 1907, ZOPF publiait une monographie, «Die
Flechtenstofîe», sur ce groupe de produits naturels. En effet, si
certaines de ces substances sont aussi synthétisées par les Champignons et
les plantes supérieures, la plupart sont caractéristiques des Lichens. Plus récemment
l'intérêt s'est accru par la découverte de l'activité biologique de certaines
d’entre elles et par leur utilité pour l'identification et la classification
des quelque 20 000 espèces de Lichens connues.
NATURE DES LICHENS
Les Lichens sont des organismes complexes résultant de
l'association de deux végétaux. L'un des constituants est chlorophyllien : ce
peut être une Algue bleue (Cyanophyte) ou, et c'est le cas le plus fréquent, une
Algue verte (Chlorophyte). L'autre constituant est un Champignon supérieur
qui appartient presque toujours à la classe des Ascomycètes.
Cet état de symbiose fait que les Lichens possèdent
certains des caractères de leurs composants et d'autres qui leur sont
propres, tant du point de vue botanique, que biochimique ou écologique.
Ce sont des végétaux cosmopolites pouvant se développer
même dans des conditions climatiques très difficiles où toute autre forme de
végétation est impossible : c'est le cas des zones arctiques et des régions de
haute altitude où les Lichens constituent l'essentiel de la Pylore.
Ils se fixent sur les supports les plus variés : roches, terre, écorces et
feuilles d'arbre, mousses... Certains même, comme Lecanora esculenla,
sont erratiques.
Ils ne sont pas, comme certains auteurs l'ont supposé, une
des premières formes de vie, mais ils ont un rôle de pionnier dans la végétation. Leurs
besoins modestes, et leur faculté de concentrer les éléments qui leur
sont nécessaires à partir de l'air et de l'eau de pluie, leur permettent
de coloniser des territoires inhospitaliers à la végétation. En contrepartie, la disparition
des Lichens des zones industrielles et urbaines est partiellement due à ce phénomène : ils
accumulent les gaz toxiques comme l'anhydride sulfureux à des doses mortelles et
peuvent être, de ce fait. utilisés comme indicateurs de pollution. Par
ailleurs. ils concentrent les produits de retombées radioactives, polluant
ainsi une chaîne alimentaire qui va jusqu’à l'homme.
Parmi les autres particularités des Lichens, nous noterons
leur croissance très lente (l'accroissement annuel des thalles varie de 0,1 à 20 mm
en moyenne) et leur étonnante longévité : les Lichens centenaires sont nombreux et l'on
connaît même certains spécimens ayant plusieurs milliers d'années.
USAGE DES LICHENS
Les Lichens ont été utilisés occasionnellement comme
aliment par l'homme, mais certains grands Lichens, comme les Cetraria ou les Cladonia,
fournissent la base de l'alimentation pour de nombreux mammifères du Grand
Nord, en particulier pour les rennes.
Différentes pharmacopées populaires ont utilisé depuis
l'antiquité des Lichens, souvent pour des raisons illusoires : un Lichen
jaune (Xanthoria parietina) était recommandé pour le traitement
de la jaunisse et Lobaria pulmonaria, à cause d'une apparence
extérieure, pour les maladies pulmonaires.
On a pu cependant montrer que certaines substances des
Lichens avaient une action antibiotique réelle : c'est le cas, par exemple, de
l'acide usnique actif contre le bacille de la tuberculose et commercialisé sous le
nom « Usno ». Par ailleurs, FUSIKAWA a remarqué des propriétés antiseptiques
notables pour les depsides et les depsidones.
Les usages industriels ont concerné l'obtention de
matières colorantes (orseilles), industrie naguère florissante, et la
fabrication de fixateurs de parfums. C'est là la seule utilisation industrielle
qui soit encore importante. Notons enfin que l'indicateur de pH appelé tournesol est
obtenu à partir de divers Lichens des genres Roccella et Lecanora.
LES SUBSTANCES
LICHÉNIQUES
Les Lichens accumulent jusqu'à des taux souvent
considérables les métabolites qu ils synthétisent. La raison de cette
accumulation est encore mystérieuse. Plusieurs hypothèses ont été
avancées : — protection de l'algue contre les radiations lumineuses, —
protection contre les prédateurs (insectes) et l'envahissement par des
bactéries ou d'autres champignons, — contrôle du développement réciproque des
partenaires de la symbiose, — modification de la perméabilité des parois
cellulaires pour faciliter les échanges entre les symbions, — rôle d'agents
chélatants pour capter les éléments métalliques du milieu...
Les structures de plus de 200 de ces métabolites ont été
établies à l'heure actuelle. Leurs propriétés et leur répartition ont été décrites en
détail dans plusieurs ouvrages récents par ASAHINA et SHIBATA, CULBERSON,
HUNECK et MOSBACH.
Leur nature chimique est très variée et nous n'allons
donner qu'un bref aperçu des grands groupes de composés rassemblés sur la base de leur
biogenèse.
A.— PRODUITS DU METABOLISME PHIMAIRE
I.
Polyols et carbohydrates
Les polyols et carbohydrates des Lichens sont issus de
l'activité photosynthétiquc de l'Algue et plus ou moins transformés par le Champignon.
Les polyols les plus répandus sont le D-arabitol, le meso-érythrytol et le mannitol. Les
Lichens produisent différents mono- et disaccharides communs aux plantes de façon
générale et quelques polysaccharides particuliers comme la lichénine. Certains
polysaccharides des Lichens possèdent une activité anticancéreuse et sont
actuellement l'objet d'études poussées.
2. Composés azotés
Les Lichens renferment des acides aminés semblables à ceux
des autres plantes. Deux cyclopeptides ont été isolés : la picroroccelline de Roccella
fuciformis et la roccanine de Roccella canariensis.
B.— PRODUITS DU MÉTABOLISME SECONDAIRE
Substances biosynthétisées par la voie
acétique-polymalonique
a — Acides et lactones aliphatiques
Les Lichens biosynthétisent une série d'acides et
d'acides-lactones par condensation d'un acide gras linéaire à longue
chaîne (acide palmitique) avec une unité à quatre atomes de carbone
(acide oxalacétique) issue du cycle tricarboxylique. On peut citer comme
exemples-types les acides rangiformique 1 et protolichestérimque II.
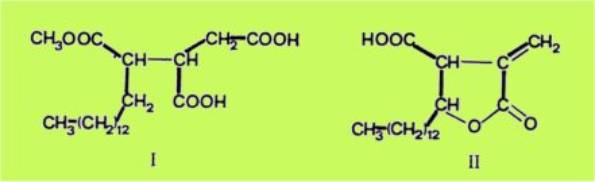
Des acides aliphatiques semblables ont été isolés dans des
Champignons non lichénisants : acide spiculisporique de Penicillium
spiculisporum et acide agaricique de Fomes officinalis
b — Composés aromatiques
1 — Pigments
La coloration jaune ou orangée de nombreux Lichens est due
à la présence de naphtoquinones, d'anthraquinones comme la pariétine III pour
les genres Xanthoria et Caloplaca, ou de xanthones comme la
norlichéxanthone IV de Lecanora straminea.
Ces composés sont formés in vivo par cyclisation
d'une chaîne poly-b-cétonique.
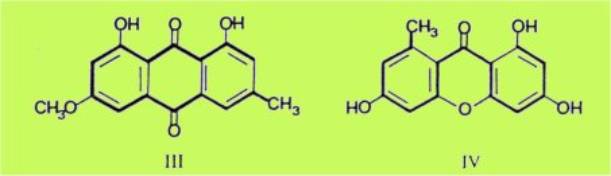
2 — Benzofurannes
On connaît plusieurs substances ayant un squelette
benzofuranne, c'est le cas de l'acide pannarique V ou de l'acide usnique VI.
Celui-ci, optiquement actif, est très répandu chez les Lichens.

L'acide pannarique est formé par une cyclisation du type
orsellinique du précurseur poly-b-cétonique, alors que l'acide usnique
est formé par une cyclisation du même précurseur du type phloroglucinol après
méthylation.
3 — Depsides et depsidones
Les depsides et les depsidones sont les composés les plus
communs des Lichens, puisqu'on en a isolé et caractérisé plus de soixante-dix.
Les depsides sont constitués par l'estérification intermoléculaire de deux ou
trois acides phénoliques. Ceux-ci peuvent être de deux types, A ou B, selon qu'ils
se rattachent à l'acide orsellinique VII (R = CH3) ou à l'acide
méthyl-3 orsellinique VIII (R' == CH3).

Le radical R, dans le cas des unités du type A, peut être
un méthyle ou une chaîne aliphatique : C3H7, C5H11, C5H15. Ces unités, comme nous
le verrons plus en détail au chapitre III, proviennent de la cyclisation d'une
chaîne poly-b-cétonique.
Le radical R', dans le cas des unités du type B, est
toujours monocarboné à un degré d'oxydation variable : méthyle, formyle... Il est
introduit par C-méthylation de la chaîne poly-b-cétonique
avant sa cyclisation.
On distingue deux groupes de depsides, selon que la
liaison ester relie la première unité à une position de la deuxième unité en para
ou en meta de sa fonction carboxyle. Le tableau suivant donne un exemple de
chaque groupe.
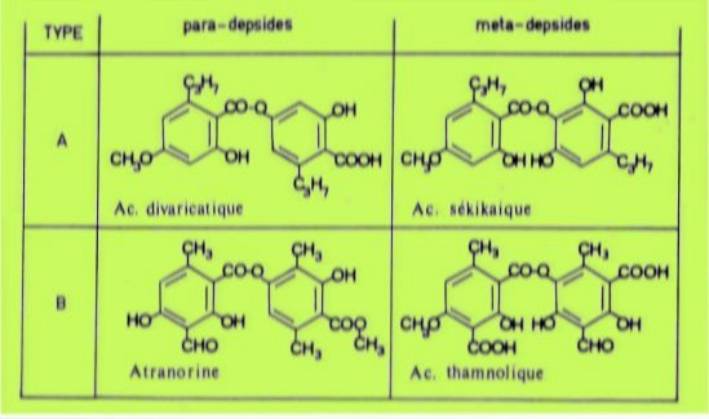
Remarquons que la formation des paradepsides est obtenue
par simple estérification, alors que celle des méta-depsides implique une
hydroxylation nucléaire puisqu'il n'y a pas d'hydroxyle en méta du carboxyle
dans les unités orselliniques.
Dans certains cas il y a intervention d'une troisième et
d'une quatrième unité pour conduire aux tridepsides et tétradepsides respectivement.
Les depsidones proviennent vraisemblablement de la
cyclisation oxydative des depsides, mais seules quelques-unes ont pu être
rattachées à des depsides connus. Elles peuvent être reliées biogénétiquement,
comme les depsides, soit à l'acide orsellinique (acide physodique IX. par
exemple), soit à l'acide méthyl-3 orsellinique (acide hypoprotocétrarique X, par exemple).
Pour toutes les depsidones connues sauf une, dont
d'ailleurs la structure est douteuse, la fonction ester est en para de
la fonction acide.
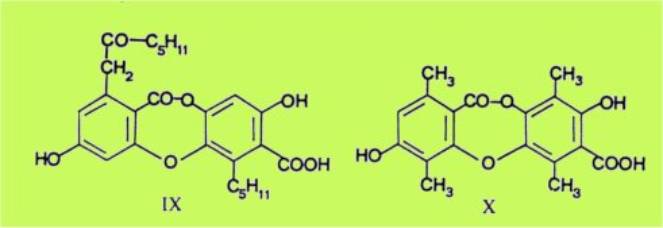
Les autres depsides et depsidones correspondent à des
variations des degrés d'O-méthylation, d'oxydation, de chloruration et de
décarboxylation des exemples cités.
1. Dérivés de l'acide mévalonique
On ne connaît qu'un diterpène chez les Lichens : le 16a-hydroxykaurane
XI, isolé de plusieurs Ramalina. Notons que le (—) kaurène, produit de
déshydratation de ce composé est le précurseur des acides gibbérelliques.
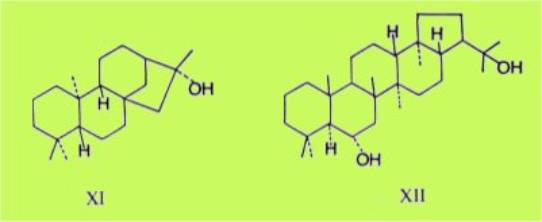
Les triterpènes sont plus répandus puisqu'on en a
caractérisé une vingtaine, leur structure dérive pour la plupart d'entre eux de l'hopane.
La zéorine XII en est le plus commun.
Trois stérols seulement ont été isolés : l'ergostérol, le
fungistérol et le b-sitostérol. Enfin, le b-carotène a été
mis en évidence dans plusieurs espèces de. Roccella.
Le petit nombre de composés d'origine isoprénique trouvé
dans les Lichens s’explique vraisemblablement par une recherche insuffisante.
2.
Dérivés de l'acide shikimique
Cette classe de composés chimiques est représentée par
quelques corps, tous très colorés. Ils proviennent de l'acide shikimique par
l'intermédiaire de l'acide phénylpyruvique. Nous ne citerons que l'acide
polyporique XIII, connu par ailleurs chez les Champignons, et l'acide
pulvinique XIV, qui en dérive et qui est le chef de file d'une série.
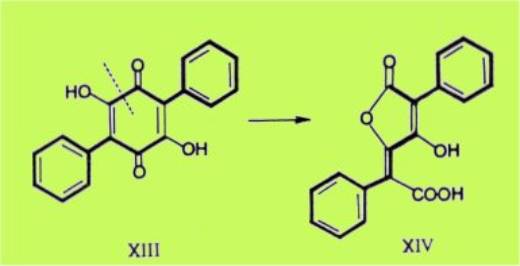
De cet examen rapide des substances lichéniques on peut
conclure que ce groupe végétal synthétise essentiellement des composés
aromatiques.
Au cours d'une recherche systématique des constituants
chimiques de Lichens du genre Ramalina nous avons isolé une substance
aliphatique de structure inconnue, présentant les caractères d'un acide
organique, que nous avons proposé de nommer acide bourgéanique. Ce nouveau
composé, qui semble avoir une large répartition, s'est révélé être le premier
«depside» aliphatique des Lichens.
Nous décrivons, dans cet exposé, l'établissement de sa
structure par des fragmentations chimiques et l'utilisation des méthodes
spectroscopiques. La synthèse de l'acide bourgéanique et l'examen de ses
propriétés chimiques nous ont permis de déduire sa structure spatiale, qui a
été confirmée par son spectre de rayons X. Plusieurs hypothèses pouvant être
envisagées pour sa synthèse in vivo, nous avons étudié, a l'aide des
traceurs radioactifs, par quelle voie cet acide était formé dans la
nature.
Mots clefs : acide / activité / algue / aliphatique /
aromatique / benzofuranne / bourgéanique / carbohydrate / carboxyle / champignon /
composé / constituant / cyclisation / depside / depsidone / fonction / lecanora / lichen /
orsellinique / pannarique / polyol / précurseur / propriété / protection / ramalina /
recherche / répartition / roccella / shikimique / structure / symbiose / synthèse / usnique /
végétation / xanthoria / bodo