Mémoire
deDuval, Cl. et Décombe, J., 1939
Sur la formule double des
composés organomagnésiens
Mémoire déposé en vue
de l'attribution en 1939 du prix de la
chambre syndicale de la grande industrie chimique
Les composés découverts par
Grignard, auxquels on donne dans l'enseignement la formule simplifiée
RMgX, ont, à l'heure actuelle, deux sortes de formules de constitution.
1°) La formule simple ou
dissymétrique (pour laquelle l'oxygène a eu sa valence
portée de deux à quatre sans le secours d'aucune expérience d'oxydation), qui
donne les deux schémas bien connus du type oxonium :
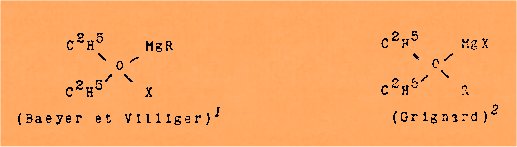
2°) La formule double ou
symétrique X2.R2Mg. 2 (C2H5)2O due à Jolibois et qu'on peut écrire, comme l'a fait Terentieff sous forme de
complexe hexacoordonné.
[MgR2X2{(C2H5)2O}2]Mg
Elles expliquent
indifféremment tous les faits expérimentaux d’ordre chimique. A ces deux
formules qui ont eu et qui ont encore leurs partisans, est venue se
superposer une nouvelle conception d'après laquelle les solutions éthérées
des composés organomagnésiens renfermeraient les deux formes simple et
double en équilibre (W.Schlenk. sen. et Jun.).
1°)
Nous avons montré expérimentalement que les composés de Grignard habituellement
formulés RMgX. (C2H5)2O doivent avoir leur schéma doublé pour satisfaire à
nos expériences de migrations d'ions, à nos mesures de conductibilité et de
poids moléculaire. La formule de Jolibois. malgré toutes les critiques
dont elle a été l'objet est donc justifiée.
2°) La théorie des affinités
nous a conduits à remplacer le magnésium anodique par du zinc ce qui nous a
donné des composés organo-zinciques, puis à remplacer le
magnésium cathodique par le calcium plus électroposItif que lui. Nous obtenons
ainsi des dérivés insolubles mais d'une technique aisée, d'une grande régularité
d'action et fournissant, jusqu’ici, des rendements accrus sur les
préparations déjà connues. La préparation de l'alliage calcium-magnésium qui leur
donne naissance est maintenant mise au point; elle peut se faire par
kilogrammes à la fois. circonstance heureuse pour exploiter la mine de recherches
qui viennent de nous être suggérées par les conceptions de Werner.
Dans ce mémoire, nous allons
exposer les expériences qui nous ont conduits à choisir la formule
double, plus particulièrement la formule complexe. Nous ne nous occuperons que
des dérivés organomagnésiens du type courant, c'est à dire de ceux qui
renferment une molécule d'éther par atome de magnésium. Nous verrons aussi que
les conclusions tirées de l'examen de cette formule double ont été
vérifiées par l'expérience.
Si la formule des organomagnésiens,
fondée sur les conceptions de Werner, a été proposée dès 1926 par Terentiew,
Duval et Décombe étudient pas à pas, expérimentalement, les conséquences de
cette formulation sur le bromure de phénylmagnésium, préparé selon la
technique de Grignard, par leur méthode de migration et de piégeage des
ions. Ils observent :
a)
à l'anode, la présence de magnésium, de brome, de benzène etd'éther. Le
rapport du magnésium au brome étant de 1/2, c'est à dire unatome de
magnésium contre deux atomes de brome,
b)
à la cathode, du magnésium sans trace de matière organique, décelable
par la 8-hydroxyquinoléine alors que le magnésium à l'anode est dissimulé à ce
réactif.
Ces faits, Joints aux déterminations
de la grandeur moléculaire, réalisées soit par voie ébullioscopique
(Grignard, Terentiew), soit par les expériences cryoscopiques toutes récentes de
Duval lui-même, conduit cet auteur à représenter les réactifs de Grignard
sous forme d'auto-complexe, à magnésium de coordinence 6, et à les incorporer
ainsi à une classe de complexes analogues, étudiée par le même chimiste.
Les organo-magnésiens s'écrivent alors :
[Mg (R)2 (X)2 {(C2H5)2 0} 2] Mg
comme
la kaïnite qui devient : [Mg Cl SO4
(H2O)3] K
la
tachydrite formulée :
l'acétate
triple d'uranyle, de magnésium et de sodium que Duval représente comme ceci
: [Mg{Uo2 (CH3 CO2)3}3]Na
la
carnallite étant [Mg Cl3 (H2O)3] K.,
3H2O
et la schonite [Mg (SO4)2 (H2O)2]K2, 4 H2O
Les
résultats de cryoscopie obtenus avec les organomagnésiens sont tels qu'ils
excluent les deux formes en équilibre : forme simple RMgX (C2H5)2O
et formule double d'autocomplexe donnée plus haut.
Depuis
1912, époque à laquelle Jolibois a opposé la formule symétrique ; (R)2 Mg,
MgX2 à la formule mixte RMgX, proposée dès l'origine par Grignard, de
nombreux auteurs ont apporté une contribution à la défense de l'une ou de
l'autre formule. Quelques chimistes, Kierzek, Ivanoff, ont pensé que
leurs expériences devaient élucider définitivement la question de la
constitution des réactifs de Grignard. Toujours, le raisonnement ne s'est pas
maintenu, à la discussion, d'une rigueur suffisante pour éviter le doute.
Les
conclusions de Duval et Décombe, pour Intéressantes qu'elles soient,
résisteront-elles à un examen plus approfondi ? Il serait souhaitable
que ces auteurs envisagent la façon de se comporter des organomagnésiens,
considérés comme autocomplexes, sur les divers groupements fonctionnels
et la formulent. Il serait désirable qu'ils lèvent les objections faites à la
formule symétrique de Jolibois et qui restent encore avec la conception
nouvelle, en ce qui concerne la formation de MgX(OH) et MgX(SH).
MM.
Duval et Décombe cependant, en accord avec la formule hexacoordonnée
des composés organomagnésiens, ont cherché à faire des hétérocomplexes,
comprenant outre le magnésium, du zinc, moins électropositif et qui devra
se trouver dans la branche anodique et des complexes magnésiocalciques; le
calcium, étant plus électropositif que le magnésium, devra se retrouver au
contraire dans la branche cathodique. Les expériences de migration d'ions ont
confirmé ces hypothèses. Duval et Décombe ajoutent donc à la série des
complexes avec magnésium hexacoordonné des composés organomagnésiens, ont cherché à faire des hétérocomplexes,
comprenant outre le magnésium, du zinc, moins électropositif et qui devra
se trouver dans la branche anodique et des complexes magnésiocalciques; le
calcium, étant plus électropositif que le magnésium, devra se retrouver au
contraire dans la branche cathodique. Les expériences de migration d'ions ont
confirmé ces hypothèses. Duval et Décombe ajoutent donc à la série des
complexes avec magnésium hexacoordonné :
[MgI2 (CH3)2{(CH3-CH2)2O}2]Ca
et considèrent les zinco-magnésiens comme répondant à la
formule :
[Zn I2 (CH3)2 (CH3CO2C2H5)2] Mg.
Mots clefs : schlenk / atome / brome / carnallite
/ chimiste / complexe / composé / constitution / cryoscopique / décombe / duval / ébullioscopique
/ éther / expérience / formule / grignard / ion / jolibois / kaïnite / magnésium / méthode /
molécule / organique / organomagnésien / oxonium / phénylmagnésium / réactif / schonite /
sodium / tachydrite / technique / terentiew / uranyle / valence / werner
de
Duval, Cl. et Décombe, J., 1939
Sur la formule double des
composés organomagnésiens
Sur la formule double des composés organomagnésiens
Mémoire déposé en vue
de l'attribution en 1939 du prix de la
chambre syndicale de la grande industrie chimique
Les composés découverts par
Grignard, auxquels on donne dans l'enseignement la formule simplifiée
RMgX, ont, à l'heure actuelle, deux sortes de formules de constitution.
1°) La formule simple ou
dissymétrique (pour laquelle l'oxygène a eu sa valence
portée de deux à quatre sans le secours d'aucune expérience d'oxydation), qui
donne les deux schémas bien connus du type oxonium :
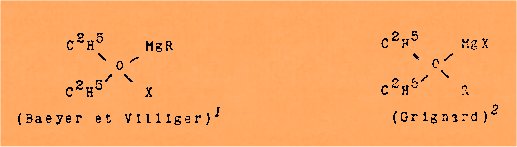
2°) La formule double ou
symétrique X2.R2Mg. 2 (C2H5)2O due à Jolibois et qu'on peut écrire, comme l'a fait Terentieff sous forme de
complexe hexacoordonné.
[MgR2X2{(C2H5)2O}2]Mg
Elles expliquent
indifféremment tous les faits expérimentaux d’ordre chimique. A ces deux
formules qui ont eu et qui ont encore leurs partisans, est venue se
superposer une nouvelle conception d'après laquelle les solutions éthérées
des composés organomagnésiens renfermeraient les deux formes simple et
double en équilibre (W.Schlenk. sen. et Jun.).
1°)
Nous avons montré expérimentalement que les composés de Grignard habituellement
formulés RMgX. (C2H5)2O doivent avoir leur schéma doublé pour satisfaire à
nos expériences de migrations d'ions, à nos mesures de conductibilité et de
poids moléculaire. La formule de Jolibois. malgré toutes les critiques
dont elle a été l'objet est donc justifiée.
2°) La théorie des affinités
nous a conduits à remplacer le magnésium anodique par du zinc ce qui nous a
donné des composés organo-zinciques, puis à remplacer le
magnésium cathodique par le calcium plus électroposItif que lui. Nous obtenons
ainsi des dérivés insolubles mais d'une technique aisée, d'une grande régularité
d'action et fournissant, jusqu’ici, des rendements accrus sur les
préparations déjà connues. La préparation de l'alliage calcium-magnésium qui leur
donne naissance est maintenant mise au point; elle peut se faire par
kilogrammes à la fois. circonstance heureuse pour exploiter la mine de recherches
qui viennent de nous être suggérées par les conceptions de Werner.
Dans ce mémoire, nous allons
exposer les expériences qui nous ont conduits à choisir la formule
double, plus particulièrement la formule complexe. Nous ne nous occuperons que
des dérivés organomagnésiens du type courant, c'est à dire de ceux qui
renferment une molécule d'éther par atome de magnésium. Nous verrons aussi que
les conclusions tirées de l'examen de cette formule double ont été
vérifiées par l'expérience.
Si la formule des organomagnésiens,
fondée sur les conceptions de Werner, a été proposée dès 1926 par Terentiew,
Duval et Décombe étudient pas à pas, expérimentalement, les conséquences de
cette formulation sur le bromure de phénylmagnésium, préparé selon la
technique de Grignard, par leur méthode de migration et de piégeage des
ions. Ils observent :
a)
à l'anode, la présence de magnésium, de brome, de benzène etd'éther. Le
rapport du magnésium au brome étant de 1/2, c'est à dire unatome de
magnésium contre deux atomes de brome,
b)
à la cathode, du magnésium sans trace de matière organique, décelable
par la 8-hydroxyquinoléine alors que le magnésium à l'anode est dissimulé à ce
réactif.
Ces faits, Joints aux déterminations
de la grandeur moléculaire, réalisées soit par voie ébullioscopique
(Grignard, Terentiew), soit par les expériences cryoscopiques toutes récentes de
Duval lui-même, conduit cet auteur à représenter les réactifs de Grignard
sous forme d'auto-complexe, à magnésium de coordinence 6, et à les incorporer
ainsi à une classe de complexes analogues, étudiée par le même chimiste.
Les organo-magnésiens s'écrivent alors :
[Mg (R)2 (X)2 {(C2H5)2 0} 2] Mg
comme
la kaïnite qui devient : [Mg Cl SO4
(H2O)3] K
la
tachydrite formulée :
l'acétate
triple d'uranyle, de magnésium et de sodium que Duval représente comme ceci
: [Mg{Uo2 (CH3 CO2)3}3]Na
la
carnallite étant [Mg Cl3 (H2O)3] K.,
3H2O
et la schonite [Mg (SO4)2 (H2O)2]K2, 4 H2O
Les
résultats de cryoscopie obtenus avec les organomagnésiens sont tels qu'ils
excluent les deux formes en équilibre : forme simple RMgX (C2H5)2O
et formule double d'autocomplexe donnée plus haut.
Depuis
1912, époque à laquelle Jolibois a opposé la formule symétrique ; (R)2 Mg,
MgX2 à la formule mixte RMgX, proposée dès l'origine par Grignard, de
nombreux auteurs ont apporté une contribution à la défense de l'une ou de
l'autre formule. Quelques chimistes, Kierzek, Ivanoff, ont pensé que
leurs expériences devaient élucider définitivement la question de la
constitution des réactifs de Grignard. Toujours, le raisonnement ne s'est pas
maintenu, à la discussion, d'une rigueur suffisante pour éviter le doute.
Les
conclusions de Duval et Décombe, pour Intéressantes qu'elles soient,
résisteront-elles à un examen plus approfondi ? Il serait souhaitable
que ces auteurs envisagent la façon de se comporter des organomagnésiens,
considérés comme autocomplexes, sur les divers groupements fonctionnels
et la formulent. Il serait désirable qu'ils lèvent les objections faites à la
formule symétrique de Jolibois et qui restent encore avec la conception
nouvelle, en ce qui concerne la formation de MgX(OH) et MgX(SH).
MM.
Duval et Décombe cependant, en accord avec la formule hexacoordonnée
des composés organomagnésiens, ont cherché à faire des hétérocomplexes,
comprenant outre le magnésium, du zinc, moins électropositif et qui devra
se trouver dans la branche anodique et des complexes magnésiocalciques; le
calcium, étant plus électropositif que le magnésium, devra se retrouver au
contraire dans la branche cathodique. Les expériences de migration d'ions ont
confirmé ces hypothèses. Duval et Décombe ajoutent donc à la série des
complexes avec magnésium hexacoordonné des composés organomagnésiens, ont cherché à faire des hétérocomplexes,
comprenant outre le magnésium, du zinc, moins électropositif et qui devra
se trouver dans la branche anodique et des complexes magnésiocalciques; le
calcium, étant plus électropositif que le magnésium, devra se retrouver au
contraire dans la branche cathodique. Les expériences de migration d'ions ont
confirmé ces hypothèses. Duval et Décombe ajoutent donc à la série des
complexes avec magnésium hexacoordonné :
[MgI2 (CH3)2{(CH3-CH2)2O}2]Ca
et considèrent les zinco-magnésiens comme répondant à la
formule :
[Zn I2 (CH3)2 (CH3CO2C2H5)2] Mg. Mots clefs : schlenk / atome / brome / carnallite
/ chimiste / complexe / composé / constitution / cryoscopique / décombe / duval / ébullioscopique
/ éther / expérience / formule / grignard / ion / jolibois / kaïnite / magnésium / méthode /
molécule / organique / organomagnésien / oxonium / phénylmagnésium / réactif / schonite /
sodium / tachydrite / technique / terentiew / uranyle / valence / werner