LA THÉORIE BIOGÉNÉTIQUE ET SON
APPLICATION AU CLASSEMENT DES SUBSTANCES ORGANIQUES D'ORIGINE VÉGÉTALE
Par
C. MENTZER
INTRODUCTION
L'une des préoccupations qui inquiètent le plus les
chercheurs de notre époque concerne la classification des connaissances.
Une découverte ne peut devenir définitive que si elle
s'intègre d'une façon simple dans un édifice harmonieux où sa place est
indiquée en quelque sorte par avance.
De vastes branches de nos disciplines les plus
importantes meurent sans cesse et tombent, tout simplement parce qu'il n'a pas
été possible de conserver les fruits qu'elles nous ont légués.
C'est pour cette raison que certaines recherches sombrent
dans l'oubli, puis sont reprises, longtemps après, comme si elles n'avaient
jamais été faites.
Les magnifiques réalisations de la chimie organique de
synthèse depuis WOHLER, c'est-à-dire depuis bientôt un siècle et demi, sont
surtout dues au mode de classement adopté peu à peu par les chercheurs, et
mises en pratique dans le remarquable ouvrage de BEILSTEIN, où tous les faits
acquis sont mentionnés, et où la moindre découverte, si modeste soit-elle, peut
servir, un jour ou l'autre, en vue de réalisations souvent grandioses.
Il est à peine besoin d'insister sur le puissant
renouveau dont a bénéficié la botanique à la suite du système de classification
proposé par LINNÉ.
Quant à la classification de MENDELEIEFF, elle a non
seulement bouleversé la chimie minérale, mais l'ensemble des disciplines
physico-chimiques, et même la physique atomique.
Une révision du système de classification au sein d'une
discipline particulière s'impose à partir du jour où les espèces ou les
individualités nouvellement décrites ne se laissent plus intégrer dans les
cadres didactiques en usage, soit que ces cadres ne correspondent plus aux
structures proposées, soit encore que l'état des recherches ait fait
brusquement apparaître des possibilités nouvelles jusque-là insoupçonnées.
C'est le cas de la biochimie végétale, que nous devons à
nouveau considérer aujourd'hui comme une discipline particulière.
En effet, alors que la biochimie générale étudie les
substances et les mécanismes communs aux animaux et aux plantes, la biochimie
végétale englobe à l'heure actuelle un groupe relativement homogène de
substances reliées entre elles par des filiations simples, mais que les
procédés classiques de présentation ne permettaient pas d'entrevoir.
Nous connaissons maintenant environ 5.000 substances
organiques d'origine végétale, de structure plus ou moins définie.
Par rapport au nombre immense de composés élaborés par
l'ensemble des espèces de plantes, c'est peu de chose. Et pourtant aucun
critère valable ne nous permettait jusqu'ici de classer ces dérivés ; si des
progrès doivent être accomplis, ce qui est non seulement souhaitable, mais
nécessaire, il faudra trouver au plus vite un autre cadre qui devra permettre
non seulement d'assigner une place à chacune des substances déjà isolées, mais
surtout à toutes celles, bien plus nombreuses, qui sont encore à découvrir.
Un tel cadre devra en outre permettre de formuler des
prévisions afin d'accélérer les découvertes, en invitant les chercheurs à
remplir les cases encore vides ; les organiciens trouveront ainsi l'occasion de
revenir à nouveau à l'étude de la Nature, qu'ils avaient en partie abandonnée
au cours des cinquante dernières années.
Il suffit de consulter quelques ouvrages classiques de
chimie végétale pour se rendre compte de l'imperfection des systèmes de
classification en usage.
Ce que nous pouvons surtout leur reprocher, c'est leur
manque d'homogénéité. Généralement plusieurs systèmes sont utilisés
simultanément, ce qui prouve d'une façon certaine que les auteurs ne se sentent
nullement satisfaits du système fondamental qu'ils avaient l'intention de
suivre.
Voici tout d'abord les modes de classification
actuellement les plus fréquents :
1)
La
classification par « fonctions » qui s'inspire directement des
données de la chimie organique classique.
2)
La
classification physiologique dans laquelle les substances sont rangées selon
leur rôle supposé ou leur action biologique : produits de réserve, d'excrétion,
aliments, enzymes, vitamines, hormones etc...
3)
La
classification botanique, calquée sur la systématique des plantes, et destinée
plus particulièrement aux travaux de biochimie comparée.
Pendant longtemps la classification chimique était la
plus utilisée.
Les chapitres les plus importants concernaient les
alcools, les aldéhydes, les cétones, les aminés, les amino-acides, les phénols,
les hétérocycles oxygénés, etc... Par exemple, des substances comme le menthol,
le cholestérol, etc., et en général tous les composés ayant dans leur molécule
une fonction hydroxyle non phénolique étaient classés dans les alcools. Mais
peu à peu, le groupe dit des terpènes s'est détaché du reste des composés
végétaux, et actuellement presque tous les auteurs consacrent aux représentants
de ce groupe un chapitre à part, dans lequel ils rangent à la fois des
carbures, des alcools, des aldéhydes, des cétones, des acides, etc. ; une telle
façon d'opérer résulte de l'avènement d'un nouveau mode de classification : à
savoir la classification «biogénétique» née surtout des travaux de RUZICKA et
de son école.
Ce nouveau système n'a pas d'emblée pu pénétrer
l’ensemble, de la phytochimie, car en en dehors des terpènes, aucun groupe de
composés végétaux n'a semblé obéir à un mode de construction aussi simple et
aussi clair.
C'est pour cette raison que pendant longtemps la plupart
des auteurs ont associé dans un même ouvrage la classification chimique et biogénétique.
Au fur et à mesure des progrès réalisés, on a également découvert dans les
plantes des substances d'une très haute activité physiologique : vitamines,
hormones, coferments, etc...
Très différentes chimiquement les unes des autres, ces
substances ont été également classées d'emblée dans des chapitres particuliers.
Il en est résulté un mode de classification «physiologique» qui, à l'heure
actuelle, est employé en même temps que les deux autres.
La question qui se pose dès lors est la suivante : Ne
serait-il pas possible, sur le plan didactique, de s'appuyer sur un mode de
classification unique, suffisamment simple pour pouvoir englober, sinon
l'ensemble, tout au moins la majeure partie des constituants élaborés par les
plantes ?
Jusqu'à présent un tel but semblait difficilement
accessible, mais à l'heure actuelle nos connaissances sur le mécanisme de
formation de la matière végétale sont suffisamment développées pour nous
permettre de généraliser la théorie biogénétique à un domaine très élargi.
Aussi le présent ouvrage constitue-t-il une première
tentative de classement des substances définies, par groupes naturels, à
l'intérieur desquels pourraient ensuite se différencier des sous-groupes et
d'autres groupements de plus en plus restreints, l'ensemble de ce système
pouvant d'ailleurs présenter une certaine analogie avec les familles, les
genres, et les espèces végétales elles-mêmes.
En ce qui concerne l'origine des hypothèses
biogénétiques, elles sont issues des travaux de RUZICKA, de ROBINSON, de BIRCH,
de WOODWARD, de JANOT et de nombreux autres auteurs ; ces hypothèses sont
maintenant bien connues et se vérifient chaque jour par l'expérience, surtout
depuis que l'emploi des molécules radioactives a donné à la biochimie dynamique
cet outil de recherches unique, connu sous le nom de «méthode des traceurs»,
dont les avantages commencent à se manifester de plus en plus.
Il ne faut pas croire cependant que le développement de
cette nouvelle méthode est seul responsable de nos progrès en matière de
biogenèse.
Si le moment est venu de changer le cadre traditionnel de
l'enseignement de la chimie végétale, et si l'époque actuelle est
particulièrement propice à un tel changement, nous le devons à un ensemble de
circonstances qui, toutes, agissent dans le même sens : besoin croissant de
nouvelles matières premières végétales nécessaires à l'alimentation, à la
médecine et, d'une façon générale, à l'ensemble de l'industrie chimique
actuelle, besoin de nouveaux types structuraux susceptibles de servir de
modèles à la synthèse organique, qui, plus que jamais, profite de l'infinie
puissance créatrice de la Nature vivante pour féconder et renouveler ses
propres méthodes, état d'esprit de nombreux chimistes actuels qui ont compris
tout le parti que leurs disciplines peuvent tirer de l'étude des plantes en
général.
La pénicilline par exemple, a révélé aux organiciens
l'existence possible d'un hétérocycle azoté à quatre chaînons, jusque-là
inconnu.
L'étude d'un tel cycle a suscité de nombreuses recherches
qui ont fécondé la chimie dans son ensemble, et qui ont récemment abouti à une
méthode de synthèse d'édifices de ce type.
D'ailleurs à aucune époque de l'histoire, la chimie
végétale n'a connu la vogue dont elle jouit à l'heure actuelle.
Et pourtant ce n'est pas une science «jeune», comme
certaines autres. De tous temps l'homme a étudié les végétaux et leurs
constituants, mais c'est seulement à la fin du XVIIIe siècle, après LAVOISIER,
après la naissance du concept de «substance pure» et de l'analyse élémentaire,
que la phytochimie a pu s'intégrer dans un édifice scientifique cohérent.
Tout être vivant est en effet caractérisé par un ensemble
de «composés organiques définis» qui constituent la matière des tissus et des
organes, et dont il faut absolument faire l'inventaire.
L'établissement d'un tel inventaire est le but
fondamental de la biochimie descriptive.
Ce but est loin d'être atteint pour diverses raisons :
tout d'abord, nous n'avons aucun critère pour évaluer, même d'une façon
approximative, le nombre de composés définis que peuvent élaborer les animaux
et les plantes.
D'autre part, l'isolement des constituants naturels, et
surtout la détermination de leur structure, est un travail particulièrement
laborieux, comparativement à la synthèse de nouvelles molécules artificielles,
qui est souvent relativement rapide.
Il suffit, pour s'en rendre compte, de jeter un coup
d'œil sur les statistiques : on connaît à l'heure actuelle de 700 à 800.000
substances organiques artificielles, alors que le nombre de composés définis
qui ont pu être isolés de l'ensemble du règne végétal est de l'ordre de cinq
mille seulement.
Il ne semble pas d'ailleurs que les méthodes actuellement
utilisées par les organiciens soient particulièrement efficaces en ce qui concerne
la synthèse de produits naturels.
En effet les corps découverts dans les êtres vivants
sont, dans l'ensemble, différents des molécules artificielles synthétisées au
laboratoire.
Parmi toutes ces molécules artificielles, quelques
centaines seulement ont été trouvées dans les végétaux, alors que 90 % environ
des constituants des plantes n'avaient jamais été synthétisés avant leur
découverte.
Cependant, malgré les difficultés inhérentes à l'étude
des substances d'origine naturelle, les progrès dans ce domaine sont absolument
considérables, comme le prouve l'examen de la courbe ci-dessous.
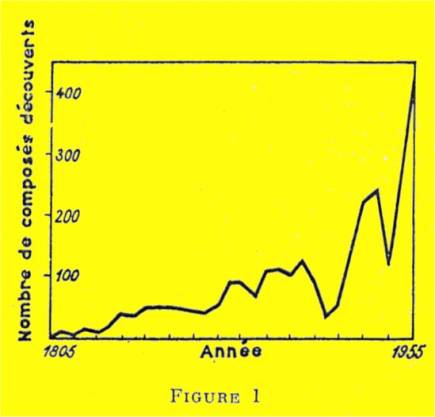
Cette courbe représente l'accroissement du nombre de
substances définies (sans compter les alcaloïdes) trouvées dans les végétaux,
depuis 1800 jusqu'à 1956.
Chaque point correspond à une durée de cinq ans.
On se rend compte facilement que le rythme des
découvertes, très lent au début du XIXe siècle, s'accélère peu à peu et atteint
une allure vertigineuse en 1956. Les deux «creux» correspondent : le premier à
la guerre de 1914-1918, le deuxième à celle de 1939-1945.
Actuellement on découvre environ vingt composés
organiques nouveaux par mois, dans l'ensemble des laboratoires du monde.
Plus que tous les autres, ces faits démontrent l'intérêt
croissant des chercheurs pour les problèmes les plus fondamentaux de la chimie
végétale, et nous incite d'une façon particulièrement pressante à rationaliser
le système de classification en usage.
Mots clefs :alcool / aldéhyde / beilstein / biochimie /
biogénétique / botanique / cétone / chercheur / chimie / classification / composé /
constituant / découverte / discipline / étude / hétérocycle / hormones / laboratoire /
lavoisier / linné / mécanisme / mendeleieff / méthode / molécule / organicien / organique /
physiologique / phytochimie / plante / progrès / recherche / ruzicka / structure / substance /
synthèse / système / terpène / végétal / végétaux / vitamine / mentzer